Qui sont les personnes étrangères arrivées récemment en Suisse et comment vivent-elles ?
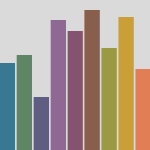
Au cours des 13 dernières années, la population suisse s’est accrue de près de 1.2 millions de personnes selon l’OFS. Plus de 80% de cette augmentation s’explique par les mouvements migratoires, et 20% seulement par l’excédent des naissances sur les décès. Puisque le débat sur l’initiative « pour une Suisse à 10 millions d’habitants » pointe un doigt accusateur sur la migration, il est important de se pencher sur celles et ceux qui contribuent aujourd’hui à cette croissance démographique.
L’enquête Migration-Mobilité fournit de nombreuses informations sur les personnes étrangères arrivées en Suisse à partir de 2006, à l’âge adulte. Cette enquête exclut toutefois les personnes venues en Suisse au titre de l’asile, un motif d’immigration qui est minoritaire (6,2% en 2023). Le mode d’échantillonnage permet de disposer de données pour la plupart des régions de provenance.
En 2024, la cinquième vague de cette enquête a confirmé la tendance à une migration de plus en plus hautement qualifiée, dictée par l’exercice d’une activité professionnelle. Quelque 64 % des personnes arrivées en Suisse après 2006 ont un niveau de formation tertiaire et 47 % d’entre elles (hommes 61 %, femmes 33 %) disposaient d’un contrat de travail ou d’une promesse d’emploi au moment de leur arrivée.
Pour celles et ceux venu·e·s en Suisse pour des raisons non professionnelles (souvent familiales), l’intégration professionnelle est certes plus complexe et conduit parfois à une déqualification, mais reste possible. Ainsi, au moment de l’enquête, 64 % des répondant·e·s déclaraient une activité professionnelle à temps plein et 20 % une activité à temps partiel.
Malgré son caractère essentiellement hautement qualifié, la migration fournit également une main-d’œuvre indispensable pour des postes à faible niveau de rémunération délaissés par les natif·ve·s. Les personnes de nationalité portugaise (61,0 %) et d’une nationalité africaine (54,8 %) présentent ainsi majoritairement un niveau de formation secondaire. Cette population moyennement qualifiée répond à la demande du marché du travail. Le taux de chômage est d’ailleurs légèrement plus faible parmi les personnes de formation secondaire I (7,4 %) ou secondaire II (6,6 %) que parmi celles de formation tertiaire (7,7 %).
L’activité professionnelle en Suisse est jugée positivement. La majorité des personnes interrogées (79,4 %) indique avoir connu une amélioration de la situation professionnelle suite à la migration. Cela s’explique notamment par le fait que la migration est souvent conditionnée à l’obtention d’un contrat de travail. Le ou la candidate dispose ainsi de la possibilité d’accepter ou non l’offre d’emploi : si elle ne correspond pas aux attentes, elle peut être refusée. Le cadre de vie en Suisse est aussi jugé positivement, même si certain·e·s répondant·e·s éprouvent des difficultés dans les contacts sociaux.
Comment les personnes étrangères se sentent-elles jugées ?
Une question de l’enquête fait référence aux rapports entre personnes natives et étrangères. Cette question porte sur la discrimination ressentie. Au total, trois-quarts (76,4 %) des personnes ayant répondu à l’enquête déclarent n’avoir jamais ou rarement ressenti de la discrimination au cours des 24 derniers mois. La proportion de personnes n’ayant jamais ou rarement été confrontées à de la discrimination augmente depuis 2018 (73,7 %), ce qui permet d’exclure l’hypothèse d’une intolérance en hausse de la part de la population suisse envers les personnes étrangères.
Ce constat rejoint les résultats des enquêtes sociales européennes (ESS), indiquant qu’une part croissante des Suisse·sse·s considère la migration comme positive pour l’économie (Rockwool Foundation, 2025).
Quels sont les projets de vie des étranger·ère·s en Suisse ?
Suite à une situation professionnelle améliorée par la migration, aux conditions de vie que la Suisse peut offrir, à la sécurité observée sur le territoire et peut-être aussi en raison de l’acceptation de la population envers les personnes étrangères, les intentions concernant la durée de séjour en Suisse se modifient progressivement. Ainsi, au moment de l’arrivée en Suisse, 22,2 % des personnes interrogées déclarent vouloir y rester pour une durée limitée, et 50,5 % n’ont pas d’opinion sur leur durée de séjour en Suisse. Seuls 27,3 % ont l’intention d’y rester toute leur vie. Cette proportion passe à 51,8 % au moment de l’enquête, indiquant que de nombreuses personnes étrangères expriment progressivement le souhait d’y rester toute leur vie.
Un souhait qu’il n’est pas toujours possible de réaliser pour des raisons légales (accès à un permis de longue durée) et économiques : notamment, les personnes étrangères arrivées au cours de la vie active et n’ayant pas cotisé l’ensemble de leur vie au système de prévoyance vieillesse doivent parfois retourner chez elles pour des raisons financières (Steiner et Wanner, 2025). Parallèlement, le retour n’est pas toujours possible pour des personnes issues de pays en crise politique ou économique.
L’envie de rester en Suisse varie pour ces raisons selon la nationalité. Elle est en effet très faible pour les ressortissant·e·s portugais·e·s (18,4 % déclarent au moment de l’enquête vouloir rester en Suisse toute leur vie), mais très élevée pour les personnes originaires d’un pays de l’Europe non communautaire (69,7 %), d’Afrique (67,7 %) et de France (62,2 %).
Quelles conséquences pour l’initiative « 10 millions » ?
Au total, les résultats de l’enquête Migration-Mobilité font ressortir une migration qui correspond aux besoins du marché du travail, perçue comme satisfaisante pour les populations immigrées et plutôt bien tolérée pour la population native. De nombreux autres travaux en Suisse et à l’étranger relèvent l’importance prioritaire d’une croissance démographique harmonieuse pour l’économie et les dépenses publiques. Face au rapide vieillissement démographique de la Suisse, qui va affaiblir le marché du travail, il est judicieux de promouvoir des politiques assurant la continuité d’un flux migratoire en adéquation avec l’économie, plutôt que de chercher à imposer des limites à celui-ci.
Philippe Wanner est professeur de démographie à l’Université de Genève et directeur adjoint du nccr – on the move. Il co-dirige le projet « The Longitudinal Impact of Crises on Economic, Social, and Mobility-Related Outcomes: The Role of Gender, Skills, and Migration Status ».
Références:
–Steiner I, Wanner P. (2025), Caractéristiques socio-économiques de la population allemande en Suisse. In P. Wanner et R. Fibbi (eds), Paysage migratoire au XXIe siècle en Suisse. Zurich : Seismo, pp 185-204.
–OFS (2025), Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel. Consulté le 2 octobre 2025.
–Rockwool Foundation (2025), Attitudes towards migration in Europe, evidence from the European Social Survey. Consulté le 2 octobre 2025.


